9 mars 2012
~ Les sorcières de Salem, Arthur Miller
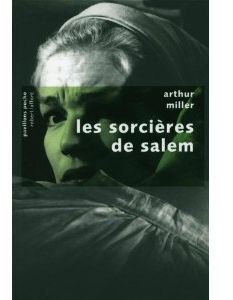 Arthur Miller romance (ou "théâtralise") le véritable châtiment de prétendues sorcières près de Salem (Massachusetts) à la fin du XVIIe siècle. L'idée est bien sûr de confronter cette "crise d'hystérie puritaine" à celle qui sévit aux Etats-Unis contre les communistes/espions (ou supposés tels) lorsque Miller écrit cette pièce, en 1952, en pleine guerre froide.
Arthur Miller romance (ou "théâtralise") le véritable châtiment de prétendues sorcières près de Salem (Massachusetts) à la fin du XVIIe siècle. L'idée est bien sûr de confronter cette "crise d'hystérie puritaine" à celle qui sévit aux Etats-Unis contre les communistes/espions (ou supposés tels) lorsque Miller écrit cette pièce, en 1952, en pleine guerre froide.
Les comportements humains aberrants décrits ici sont transposables au maccarthysme, mais aussi à n'importe quel phénomène de rumeur, de suspicion, de paranoïa collective, de chaos. L'individu, libéré de certaines saines entraves peut se laisser aller, dénoncer impunément son voisin, son ennemi, son rival, par vengeance, peur, lâcheté, intérêt financier.
La pièce de Miller met en outre en évidence les paradoxes des religions, la difficulté d'en appliquer les principes de manière cohérente, tant les hommes les ont réécrits, remaniés, différemment interprétés au gré des besoins.
Bref, tout cela est très intéressant, mais... j'émets une réserve sur le style. Ce texte m'a semblé aussi difficile à suivre que Mort d'un commis voyageur du même auteur (au moins sur le premier acte), en raison de la pléthore de personnages, qui, de surcroît, entrent en scène et sortent du décor sans que cela soit clairement signifié dans la structure théâtrale.
Notons que cette pièce fut traduite et adaptée en France par Marcel Aymé, dès 1955, et que l'on y trouve parmi les acteurs principaux Montand et Signoret (ayant pris parti en faveur des époux Rosenberg quelque temps plus tôt).
Les sorcières de Salem, Arthur Miller, Robert Laffont, Pavillons poche, avril 2010, 238 p.
Challenge petit Bac de Enna, catégories Métier/fonction et Lieu

Publicité
Publicité
Commentaires
J
L
C
T
C




/http%3A%2F%2Fstorage.canalblog.com%2F71%2F00%2F624058%2F81179501_o.jpg)
/image%2F1079560%2F20240421%2Fob_9a6fac_la-colline.jpg)
/image%2F1079560%2F20240424%2Fob_fdaced_l-amour.jpg)
/image%2F1079560%2F20240422%2Fob_663b63_ni-web.jpg)
/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F5%2F3%2F536564.jpg)